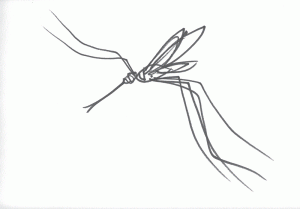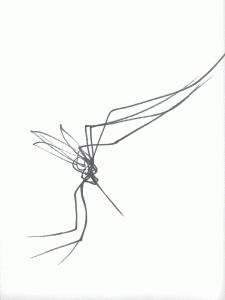Göttingen, de la réticence à l’évidence
Joël July
Émile Noël : Est-ce que vous croyez que la chanson peut servir à faire prendre conscience ?
Barbara : Non. Moi je n’ai jamais pensé que la chanson faisait prendre conscience de quoi que ce soit, ni qu’on refaisait le monde avec des chansons, ni qu’on faisait la guerre avec des chansons. Il faut descendre dans la rue, ou… vous comprenez ? Alors quand on me dit : vous faites des chansons engagées, j’ai honte. Parce que je ne fais pas de chansons engagées. Ou quand on dit : vous n’en faites pas. Je dis non. Je n’ai pas honte, là, parce que c’est vrai : je n’en fais pas. Je fais des chansons d’amour. Göttingen, c’est une chanson d’amour. La chanson, c’est la la la, pour moi, ça reste la la la.
Extrait de Profils Barbara, producteur Émile Noël, enregistré le 29 mai 1970 et diffusé le 17 août 1970 sur France Culture, repris sur le CD 1 du coffret Le Temps du Lilas, novembre 2007
Göttingen
Bien sûr ce n’est pas la Seine
Ce n’est pas le bois de Vincennes
Mais c’est bien joli tout de même
À Göttingen, à Göttingen.
Pas de quais et pas de rengaines
Qui se lamentent et qui se traînent
Mais l’amour y fleurit quand même
À Göttingen, à Göttingen.
Ils savent mieux que nous, je pense
L’histoire de nos rois de France,
Hermann, Peter, Helga et Hans
À Göttingen.
Et que personne ne s’offense
Mais les contes de notre enfance
« Il était une fois » commencent
À Göttingen.
Bien sûr nous, nous avons la Seine
Et puis notre bois de Vincennes
Mais Dieu que les roses sont belles
À Göttingen, à Göttingen.
Nous, nous avons nos matins blêmes
Et l’âme grise de Verlaine
Eux, c’est la mélancolie même
À Göttingen, à Göttingen.
Quand ils ne savent rien nous dire
Ils restent là, à nous sourire
Mais nous les comprenons quand
même
Les enfants blonds de Göttingen.
Et tant pis pour ceux qui s’étonnent
Et que les autres me pardonnent
Mais les enfants ce sont les mêmes
À Paris ou à Göttingen.
Ô faites que jamais ne revienne
Le temps du sang et de la haine
Car il y a des gens que j’aime
À Göttingen, à Göttingen.
Et lorsque sonnerait l’alarme
S’il fallait reprendre les armes
Mon coeur verserait une larme
Pour Göttingen, pour Göttingen.
© Éditions Métropolitaines, 1965
Il y a un brin de provocation à mettre en épigraphe de cette analyse une phrase polémique sortie du contexte de cette interview de 1970. Barbara ne dit pas qu’elle aurait honte de faire des textes engagés mais elle dit qu’elle a honte lorsque des journalistes l’affirment alors que son intention de créatrice était autre. Mais ne cherche-t-elle pas, par l’alternative finale («ou quand on dit», etc.), qui vaut nuance rectificatrice, à faire oublier son idée première, politiquement incorrecte pour une chanteuse née en Rive Gauche ? Tout le début de sa réponse, spontanée et rigoureuse, ne nous confirme-t-il pas que Barbara aurait effectivement de l’humeur si l’on donnait à ses textes une autre mission que celle de mettre le coeur à nu, si on cherchait à les détourner de leur fonction cathartique, si on voulait les orienter… Il faut donc relire Göttingen avec la douceur aimable qui présida à sa création, lui restituer toute la pudeur et la prudence de l’artiste juive qui l’osa car ce sont ces accents d’ humanité qui transformèrent la chanson en hymne.
Göttingen : une chanson à évidences
Göttingen est une ritournelle improvisée en juillet 1964 par une jeune chanteuse, à peine connue en France, invitée dans une ville universitaire ouest-allemande et qui trouve pour remercier ce public chaleureux, l’avant-veille de son départ, les mots de la réunification, sans tout à fait s’en douter. Et ce qui lui donne ses accents de sincérité, au-delà d’un hommage convenu, c’est justement cette prudente progression de l’éloge qui passe par plusieurs concessions à la ville de Paris, d’abord implicitement désignée. Le texte prend pour toile de fond une confrontation entre la France et l’Allemagne et celle-ci se met, au final, en huitième strophe, au service d’une comparaison égalitaire, point d’orgue de la chanson comme le prouveraient le ralentissement de la valse à cet endroit et le suspens vocal : «Mais les enfants ce sont les mêmes / À Paris ou à Göttingen» (vers 31-32). Mais le texte ne polémique pas, s’excuse même en amont de ce qui pourrait représenter une indécence : «Tant pis pour ceux qui s’étonnent / Et que les autres me pardonnent» (1). Et en aval, un vers viendra encore mettre des limites à cette envolée pacifiste : S’il fallait reprendre les armes» (vers 38). Que les choses soient claires, nous ne sommes pas dans Le déserteur (2) de Boris Vian, créé dix ans plus tôt. C’est un texte du pardon mais pas de la démission ou de la désolation. C’est un texte du pardon qui a continuellement à l’esprit tout ce qu’il y a à pardonner et tout ce qu’il en coûte(3) ; d’où sa force. Et pour mimer cet effort sur soi que doit faire l’auditeur parisien, français et/ou juif, la chanson expose nos préjugés chauvins, nous laisse plusieurs fois les savourer, pour mieux les dépasser.
Art populaire qui travaille sur les stéréotypes, la chanson part fréquemment du présupposé idéologique, du convenu de l’idée. Souvent, elle finira par le contester, comme l’illustrent les nombreuses chansons qui s’appuient sur un schéma de concession et s’ouvrent sur la locution adverbiale Bien sûr (4). Autour de Göttingen de Barbara, nous pourrions citer deux autres textes qui fonctionnent sur la reprise anaphorique de cet embrayeur : ce serait La Chanson des vieux amants de Jacques Brel, texte tardif créé en 1967, et D’aventure en aventure de Serge Lama, qui date de 1968 et donne son nom à un album de l’auteur interprète.
(1) Plus tôt dans le texte, nous trouvons déjà des marques de modération et d’atténuation du propos politiquement incorrect : l’incidente subjective « je pense » (vers 9), la formule de souhait «Que personne ne s’offense» (vers 13). (2) Nous parlons de la version connue de la chanson de Boris Vian puisque la première ébauche de Vian ne prévoyait pas de laisser les gendarmes tirer sur le locuteur antimilitariste mais au contraire de se défendre. (3) «[…]un profond désir de réconciliation mais non d’oubli», dira Barbara dans ses Mémoires interrompus, Il était un piano noir..., Fayard, 1997, p. 168. (4) Vers 1 et 17, chacune de ces anaphores ouvre un mouvement musical similaire qui sera constitué d’un ensemble de quatre quatrains.
La première parenté se fait assez naturellement puisque Barbara et Brel sont de la même génération, à un an près, ce sont deux auteurs de chansons à texte des années 50-60 aux multiples accointances (1):
Bien sûr, nous eûmes des orages […]
Bien sûr tu pris quelques amants […]
Mais mon amour
Mon doux mon tendre mon merveilleux amour
De l’aube claire jusqu’ à la fin du jour
Je t’aime encore tu sais je t’aime […]
Bien sûr tu pleures un peu moins tôt
Je me déchire un peu plus tard
Nous protégeons moins nos mystères […]
Mais c’est toujours la tendre guerre.
Le lien entre Serge Lama et Barbara est moins connu mais plus vibrant dans le cadre étroit de cette chanson. Serge Lama fit aussi ses débuts au cabaret parisien de L’Écluse(2) au temps où Barbara y était la vedette, juste avant qu’elle ne quitte les lieux(3). Il se fiance avec Liliane Benelli, la pianiste du cabaret, avec laquelle il aura un accident de voiture, où elle perdra la vie, le 12 août 1965, peu avant leurs noces. Cette superbe chanson lui est dédiée tout comme le sera Une petite cantate de Barbara en 1965, sur le même album que Göttingen :
Bien sûr, j’ai d’autres certitudes
J’ai d’autres habitudes
Et d’autres que toi sont venues
Les lèvres tendres, les mains nues
Bien sûr
Bien sûr j’ai murmuré leurs noms
J’ai caressé leur front
Et j’ai partagé leurs frissons.
Mais d’aventure en aventure
De train en train, de port en port
Jamais encore, je te le jure
Je n’ai pu oublier ton corps […]
(1) Rappelons que Brel et Barbara étaient très amis : au fil des interviews, le premier évoque entre eux une passion secrète sur le ton badin, la seconde prend le rôle féminin principal (Léonie) dans son premier film Franz en 1972. Textuellement, il a pu être relevé de nombreuses similitudes dans leurs pratiques scripturales : cf. Joël July, Les Mots de Barbara, PUP, Textuelles, 2004. 2. Cabaret situé rue des Grands-Augustins sur la rive gauche de la Seine où Barbara s’installa dès 1956 pour y devenir progressivement la « chanteuse de minuit », donc le clou du spectacle. 3. Serge Lama est programmé à partir du 11 février 1964 à L’Écluse et Barbara cessera son récital quotidien à partir du mois de mai.
Ces chansons nous prennent à rebrousse poil ; elles retournent nos idées préconçues. «Le temps amoindrit la passion» pour celle qu’exploite Brel, «Le temps efface les deuils» pour celle de Lama. Mais l’un et l’autre finissent par suggérer puis clamer le contraire de ce qu’ils ont préalablement entériné. Il semble qu’ils ont d’emblée affiché en tête les évidences du contrat social, du tout-venant psychologique, comme des témoins à charge, pour mieux ensuite les réfuter. Ainsi ces chansons caressent la bien-pensance pour la faire doucement dévier (ou brutalement dévier, ce seront alors aux autres media sémiotiques, voix et musique, à jouer leur rôle).
Cette comparaison avec d’autres textes au schéma identique permet d’illustrer le fonctionnement argumentatif de Göttingen. Il s’agit de présenter d’abord les mérites de la France, sa géographie, son histoire, sa culture, pour glisser progressivement vers ceux de l’Allemagne et tenter inconsciemment de réveiller chez le lecteur/auditeur sa prise de conscience humaniste. On peut suivre le propre cheminement de Barbara, et c’est donc cette précaution qui va émouvoir : au début, dans la première strophe, la comparaison est quasi annulée par la connotation galvaudée du compliment «bien joli(1)», le propos est presque condescendant vis-à-vis de la ville allemande ;
1. Le brouillon de cette chanson, griffonné l’avant-dernier jour du récital en Allemagne, propose en guise de premier quatrain : Bien sûr il n’y a pas la Seine / Et c’est loin du pont de Suresnes / Mais c’est très joli tout de même / À Göttingen. cf. Barbara, L’Intégrale, édition revue et corrigée, Joël July (dir.), L’Archipel, 2012, p. 82.
les locutions adverbiales tout de même et quand même aux vers 3 et 7 peuvent aussi bien servir que desservir la cause défendue, selon le ton employé(1) pour les prononcer ; le lecteur/auditeur français pourrait donc d’abord s’autosatisfaire d’une comparaison a minima, au rabais. Mais à la suite, le comparatif d’égalité cède la place à une supériorité de l’Allemagne : «Ils savent mieux que nous» (vers 9) ; dans le deuxième mouvement de la chanson (des quatrains 5 à 8), la réfutation des mérites parisiens tombe sous l’évidence d’une exclamation enthousiaste «Dieu que les roses sont belles» (vers 19) ; enfin, les strophes 4 et 6 pointent chacune une suprématie de l’autre côté du Rhin :
Mais les contes de notre enfance
« Il était une fois » commencent
À Göttingen.(2)
Eux, c’est la mélancolie même(3)
Par sa prudence, en retournant les évidences, Barbara mime ses propres réticences, au diapason de celles qu’un auditeur de 1964 pouvait ressentir
Une chanson à réticences
C’était donc en 1964, un an après la signature du traité de l’Élysée, qui scella l’amitié entre la France et l’Allemagne. C’était aussi l’époque où les Allemands étaient encore des «Boches» pour beaucoup de Français.
(1) Ces locutions peuvent marquer une réfutation violente et indignée dans certains contextes (que l’on accommode d’ailleurs de modalisations épistémiques ironiques : Il faudrait peut-être quand même se décider !) mais elles peuvent aussi dans d’autres cas atténuer une réaffirmation de thèse à laquelle on ne voudrait pas donner tout crédit (que l’on poursuit d’ailleurs prudemment d’une question rhétorique : Il faudrait quand même se décider, non ?). « On voit par là que quand même est, en soi, porteur d’un mouvement autodialogique par lequel le locuteur soupèse le pour et le contre d’une assertion ». Sylvie Mellet, «Quand même, à la croisée des approches énonciatives», XXVe congrès International de linguistique et philologie romanes (CILPR), Innsbruck, Autriche, 2007, p. 4. (2) On pourra tout particulièrement apprécier l’ingéniosité de cette formulation, même si elle relègue d’autres traditions fabulistes et, d’un point de vue strictement littéraire, oublie Charles Perrault pour privilégier les frères Grimm : les contes de notre enfance commencent par « Il était une fois ». En insérant au milieu de la syntaxe une phrase clichéique, liminaire des contes et apte à accueillir à son compte le verbe commencer, Barbara propose un élégant jeu polysémique. (3) Entrent au service de ce dispositif comparatif les pronoms personnels et l’alternance entre les représentants de la première personne du pluriel et ceux de la troisième personne du pluriel. Ici, le pronom est accentué en attaque de vers et la «mélancolie» est mise en relief derrière un présentatif.
Tombé sous le charme de l’artiste française qu’il voit à L’Écluse, un jeune directeur de théâtre de Göttingen, Hans-Günther Klein, va s’entêter pour convaincre Barbara de venir chanter dans son établissement de cent quarante places. Il essuie un refus, insiste ; finalement un contrat sera signé en avril et Barbara aura pris soin de poser une condition essentielle : qu’il y ait un piano demi-queue noir(1).
«Je pars donc pour Göttingen en ce mois de juillet 1964. Seule et déjà en colère d’avoir accepté d’aller chanter en Allemagne», écrira dans ses Mémoires la chanteuse(2), née Monique Serf. Barbara n’avait rien oublié de la petite fille juive qu’elle avait été et qui dut se cacher pour échapper aux rafles. Et elle n’était pas encore tout à fait prête à se réconcilier. En réalité, « L’Allemagne était comme une griffe», confiera Barbara(3). Or, à son arrivée le 4 juillet 1964, dans cette ville au centre de l’Allemagne, au sud d’Hanovre, pour la répétition, c’est la consternation : un énorme piano droit trône sur la scène. Barbara refuse de jouer. Ce piano tout en hauteur lui bouche la vue. Elle veut voir son public, il lui faut un piano à queue. Le directeur de théâtre a beau lui expliquer que les déménageurs de piano de Göttingen font grève, Barbara reste inflexible : sans ça, elle ne jouera pas ! Les anecdotes pianistiques font partie de la légende de la «Femme-piano (4)» mais celle-ci prend une valeur particulière pour contextualiser Göttingen et prouver les réticences de Barbara à chanter en Allemagne en 1964. Quelques heures plus tard, néanmoins, dix étudiants(5) hissent sur la scène un piano à queue noir Steinway, qu’ils viennent d’emprunter à une vieille dame.
(1) Nous suivons ici la version proposée par Barbara elle-même et que nombre de biographes exploitent pour son aspect romantique. L’anecdote évoquée par Valérie Lehoux dans Barbara, Portrait en clair-obscur (Fayard, coll « Chorus », 2007, p. 315 et sq.) propose des divergences : Barbara aurait seulement été contactée par courrier en avril 1964 par Sibylle Penkert. Si tel est le cas, le fait que Barbara dans son autobiographie inachevée ait imaginé, comme par excuse, un harcèlement du séduisant Günther Klein pour lui faire accepter un récital à Göttingen cadrerait encore mieux avec le motif des réticences, comme s’il avait fallu, même a posteriori, en ajouter, et se justifier du déplacement Outre-Rhin. (2) Il était un piano noir..., op. cit., p. 165. Tous les événements qui s’inscrivent dans le voyage à Göttingen sont entièrement rédigés par Barbara dans ses mémoires (pages 162 à 168). (3) Synergie, France Inter, 27/12/1996. (4) Dernier surnom mais aussi dernier titre de Barbara dans l’album studio testamentaire sorti en 1996. (5) Dix étudiants dont il est coutumier d’entendre une trace autobiographique dont la chanson conserverait le souvenir, grâce à l’énumération de la strophe 3 de Göttingen.
Mais le temps de tout ce remue- ménage, la salle est comble. Barbara n’a pas répété, le concert va commencer avec une heure trente de retard. Pourtant, c’est une ovation. La chanteuse connaît un tel triomphe qu’elle accepte alors de rester une semaine de plus, alors que la programmation n’était au départ prévue que pour trois soirées ; elle se produit donc tous les soirs suivants au Junges Theater. Chaque fois deux tours de chant sont proposés : le premier à 20h15, le second à 22 heures. La chanteuse, qui au départ ne voulait rien voir de l’Allemagne, accepte de suivre les étudiants qui lui font visiter toute la ville, y compris l’ancienne maison des frères Grimm, les célèbres collectionneurs de contes. Pendant cette semaine, Barbara rencontre les professeurs de la grande université Georg-August de Göttingen, où quarante-deux Prix Nobel ont enseigné ou étudié. Elle est agréablement surprise par la beauté du site, les connaissances en français de ses hôtes, la chaleur de l’accueil. Göttingen est une jolie ville épargnée par les bombardements. Dans la journée, Barbara flâne dans les jardins ; et puis une intrigue sentimentale s’est probablement nouée à ce moment-là avec Günther Klein(1). L’avant-dernier jour, elle écrira finalement Göttingen dans un petit jardin jouxtant le théâtre. C’est là que la chanson affleure. Ce sera son remerciement. Le soir même, elle interprète la chanson à moitié terminée devant un public enthousiaste et ému à la fois. Dans son autobiographie inachevée Il était un piano noir…, elle écrit :
C’est dans le petit jardin contigu au théâtre que j’ai gribouillé Göttingen, le dernier après-midi de mon séjour. Le dernier soir, tout en m’excusant, j’en ai lu et chanté les paroles sur une musique inachevée. J’ai terminé cette chanson à Paris, et Claude Dejacques, en l’entendant, décida que je devais l’enregistrer dans mon prochain disque(2).
En juillet 1965, elle enregistre au studio Blanqui la chanson3, sur son deuxième album personnel. En Allemagne, le succès est tel qu’on lui demande d’aller traduire ce second disque, sur lequel figure la chanson hommage. Marie Chaix, sa secrétaire, est bilingue. En mai 1967, celle-ci l’accompagne à Hambourg, lui enseigne vaille que vaille le système phonologique qui lui permettrait une prononciation correcte, et surtout la guide scrupuleusement pendant l’enregistrement.
1. Cf. Alain Wodrascka, Barbara, Une vie romanesque, éd. Cherche-Midi, Documents, 2013, p. 137. 2. Il était un piano noir..., op. cit., p. 168. 3. Göttingen sera reprise peu de temps après sa sortie par Jean-Claude Pascal. Elle sera l’objet de nombreuses versions et de traductions célèbres comme celle de Soledad Bravo.
Mais pour elle, comme pour Barbara, Göttingen tient lieu de résilience : Marie Chaix est née en 1942 d’un père collaborateur et d’une mère allemande. Seule Barbara partage alors ce lourd secret(1). Barbara enregistre à Hambourg la version allemande de sa chanson sur l’album Barbara singt Barbara. Elle donnera un concert à la Stadthalle de Göttingen en octobre 1967. L’événement est l’occasion d’une Journée Barbara sur France-Inter, qui débute la matinée par une évocation du récital de 1964.
Rappelons que Lorsque Barbara reviendra à Göttingen en 1967, le jeune Günther Klein, qui l’avait accueilli et séduite à l’hôtel du Soleil d’or, est décédé. Ce fait pourrait justifier l’écriture d’une autre chanson au prétexte moins explicitement autobiographique Le Soleil noir, qui constituera la chanson titre du quatrième album de Barbara, en 1968.
Au niveau intellectuel comme au niveau sentimental, Göttingen et Göttingen sont un événement rédempteur et régénérateur dans l’existence et la création de Barbara. Cela ne fait aucun doute.
Une chanson à élégances
Loin de toute prise de position radicale, en 1964, Barbara tira de son voyage outre-Rhin une modeste leçon humaniste, dont elle fut apparemment la première surprise. Et le texte reproduisit même avec naïveté, en tous les cas avec spontanéité et sincérité, cet étonnement qui devint un éblouissement.
Or il s’avère que Barbara est d’origine juive, que sa chanson rencontrera le succès, dont les hommes politiques se serviront comme étendard promotionnel quand l’amitié franco-allemande deviendra dans les années 80 un sujet d’actualité avec le chancelier Helmut Kohl. Ainsi, en 1988, François Mitterrand remit à Barbara la Légion d’Honneur en évoquant Göttingen lors de son discours2 ; d’ailleurs, en 1992, à la veille d’un référendum, le Président de la République choisit ce titre pour terminer un entretien télévisé. La version allemande de Göttingen figure en bonne place dans la compilation 1997 et Barbara reçut en 1998 la médaille d’honneur de la ville de Göttingen et l’ordre du mérite fédéral.
1. Cf. pour l’évocation de l’enregistrement de l’album en allemand : Didier Millot, Barbara, J’ai traversé la scène, 2004, éd. Mille et une nuits, p. 66-67 ; Cf. pour les confessions de Marie Chaix au sujet de sa complicité avec Barbara : Barbara, Libretto, 2013, p. 53-57. 2. Cf. Alain Wodrascka, op. cit., p. 533.
En 2003, en France, la chanson fut reprise dans les écoles lors des commémorations du quarantième anniversaire du Traité de L’Élysée, à l’instar de l’allocution du 9 septembre 1962, prononcée par le général de Gaulle à l’intention de la jeunesse allemande. Dans le livre unique de Français 3e À mots ouverts, édition Hatier, est proposée l’étude du texte de la chanson Göttingen dans le chapitre Les formes implicites de l’argumentation. Aujourd’hui, on décrypte à l’évidence Göttingen comme un chant de la réconciliation entre les peuples ; d’autant qu’en 2003 le chancelier Schröder, commémorant le traité d’amitié franco-allemande de 1963, entonna les dernières strophes. À Göttingen, une «Barbarastrasse» a été inaugurée en 2002 dans le quartier de Geismar, pour rendre hommage à la chanteuse décorée de la «Bundesverdienstkreuz», la plus haute distinction allemande.
Ce n’est donc pas la chanson elle-même qui se fait hymne ; c’est son succès qui lui offre ce statut. D’ailleurs, souvent, les chansons qui se revendiquent et s’autoproclament à portée humanitaire font long feu. Il faut donc correctement analyser le processus de la postérité : un contexte tout étrange et local, très anecdotique, permet à Barbara – et en même temps autorise, stimule, commande – l’écriture au plus près du sentiment d’un texte enthousiaste. Celui-ci tisse son élégance avec une structure légère (des octosyllabes rapides(1), un raccourcissement du vers pour l’épiphore de chaque quatrain, qui varie mais sert tout de même de refrain mélodieux et insistant à la ritournelle, des rimes approximatives mais tout de même originales et gracieuses, toutes féminines), avec un mélange de syntaxe, de lexique et de références littéraires (les vocatifs, les souhaits au subjonctif, les références géographiques et l’allusion à Verlaine(2) ) et, par ailleurs, des tournures populaires comme les nombreux présentatifs (vers 2, 3, 23, 35), des phrases nominales (deuxième quatrain), des dislocations (vers 17, 21, 23, 27). La musique suit cette double orientation : valse rapide pour délester l’ambiance et passage en voix grave et ralentie lors des épiphores pour la relester, dramatisation des deux derniers quatrains mais vocalises inimitables pour achever la performance.
1. On notera d’ailleurs que le premier vers ne respecte pas la métrique en ne comptant que sept syllabes, obligeant parfois certains repreneurs mal aguerris à prolonger la locution adverbiale bien sûr frauduleusement sur trois syllabes. 2. Cf. pour l’intertexte rimbaldien et verlainien dans les chansons de Barbara, Joël July, Les Mots de Barbara, op. cit., p. 272-275.
Enfin, à partir de cette chanson élégante, fluide et naturelle, un peu plus que d’autres, à partir de cette chanson authentique, prudente et sincère, un peu plus que d’autres, l’auditeur, en confiance et en harmonie, opère un mouvement de conscience ; il se dit : « c’est bien joli tout de même » au début, et convient au finale que son coeur à lui aussi « verserait une larme » ; il est capté, charmé, persuadé. Alors, ce qui n’était peut-être que le geste créatif d’une jeune femme d’origine juive encore peu connue en 1965, qui tout en ne voulant pas froisser les susceptibilités françaises tient quand même à remercier(1) un public allemand chaleureux, devient historiquement un acte politique précurseur et fondateur, symbolique.
1. Ce sera tout à fait la même démarche (moins inconsciente peut-être pour ce bis repetita) que celle qui transformera Ma plus belle histoire d’amour en chanson métaleptique (métatexte, mise en abyme) par excellence.