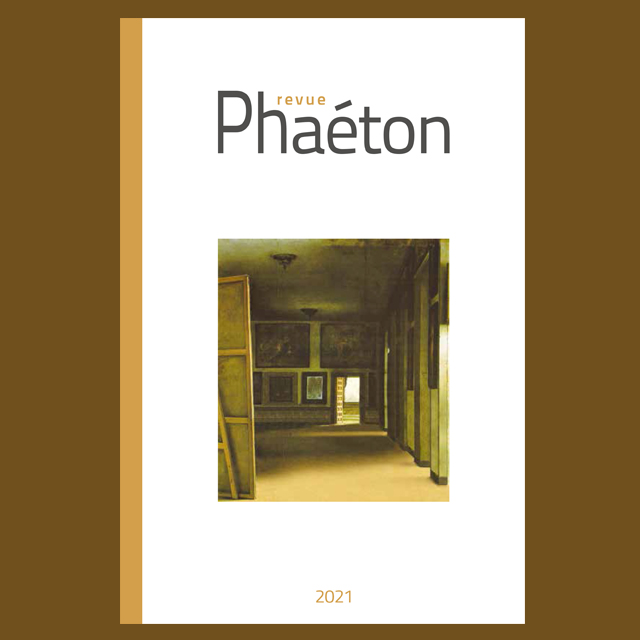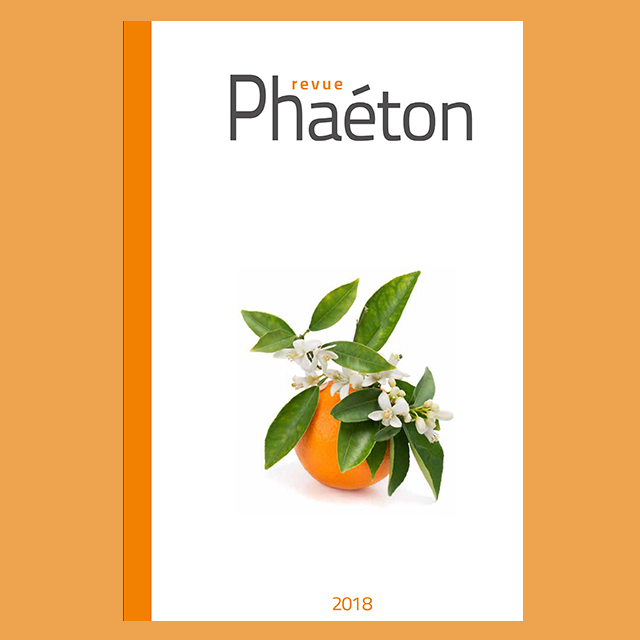Le Désespoir, forme supérieure de la critique
Jean-Michel Devésa
Jean-Michel Devésa est écrivain, professeur de lettres à l’Université de Limoges. Il a exercé également dans diverses universités en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Ses thématiques de recherche concernent essentiellement les avant-gardes du XXe siècle, la littérature française de l’extrême contemporain et les littératures de la Francophonie. Il vient de publier son premier roman, Bordeaux la mémoire des pierres, aux éditions Mollat.
«La poésie contemporaine ne chante plus. Elle rampe.»
Léo Ferré, Préface, (Il n’y a plus rien)
« Je n’écris pas comme de Gaulle ou comme Perse
Je CAUSE et je GUEULE comme un chien
JE SUIS UN CHIEN »
Léo Ferré, Le Chien (Amour Anarchie)
Pas plus qu’une autre, l’oeuvre de Ferré ne parle d’elle-même. Et comme en la matière il importe que chacun détermine son mode d’appréhension, en fonction évidemment de ses conceptions théoriques et de sa vision de l’art, mais aussi de sa propre histoire, je crois utile de préciser que, depuis l’âge de quatorze ans, Ferré n’a jamais cessé d’accompagner ma traversée de l’existence, des rêves et des textes…
Comme un saxo gueulant des chants désespérés
Léo Ferré m’a d’abord fourni la voix libertaire et rebelle qui a épicé le marxisme-léninisme de mes années militantes (1) quand, avec mes plus proches ami(e)s, lesquel(le)s étaient toutes et tous des camarades, pour tuer la nuit à la suite d’un collage d’affiches ou dans une retraite à la campagne sous le brûlant soleil du printemps 76, nous entonnions à l’unisson (2) les stances de «Il n’y a plus rien (3)» et que nous reprenions en coeur les vers de « Les Anarchistes (4)», jaloux et furieux à la fois que notre courant de pensée et d’action (5) fût incapable de se doter d’un hymne aussi puissant et généreux, jusque dans une grandiloquence qui, en cultivant l’hyperbole, se désamorce d’elle-même pour tourner en une simple mais souveraine manifestation de fraternité : «Qu’y’en a pas un sur cent et qu’pourtant ils existent/Et qu’ils se tiennent bien bras dessus bras dessous/ Joyeux et c’est pour ça qu’ils sont toujours debout/Les anarchistes ».
(1) Ici, je n’ai pas d’autre choix que de rapprocher mes pauvres souvenirs de ces observations consignées par André Breton dans Arcane 17 : « Le drapeau rouge, tout pur de marques et d’insignes, je retrouverai toujours pour lui l’oeil que j’ai pu avoir à dix-sept ans, quand, au cours d’une manifestation populaire, aux approches de l’autre guerre, je l’ai vu se déployer par milliers dans le ciel bas du Pré Saint-Gervais. Et pourtant - je
sens que par raison je n’y puis rien - je continuerai à frémir plus encore à l’évocation du moment où cette mer flamboyante, par places peu nombreuses et bien circonscrites, s’est trouée de l’envol de drapeaux noirs. »
(2) Autour de la guitare de Serge Pantchenko.
(3) « Et les microbes de la connerie que vous n’aurez pas manqué de nous léguer, montant/ De vos fumures/De vos livres engrangés dans vos silothèques/De vos documents publics/De vos règlements d’administration pénitentiaire/De vos décrets/De vos prières, même,/Tous ces microbes…/Soyez tranquilles,/Nous avons déjà des machines
pour les révoquer// NOUS AURONS TOUT//Dans dix mille ans.»
(4) « Ils ont un drapeau noir/En berne sur l’Espoir/Et la mélancolie/Pour traîner dans la vie/Des couteaux pour trancher/Le pain de l’Amitié/Et des armes rouillées/Pour ne pas oublier»
(5) En dépit de la sympathie que j’ai éprouvée pour l’homme (accueilli sur «notre » campus pour un «meeting-concert»), j’ai toujours trouvé assez « pathétique » que Maurice Fanon ait éprouvé le besoin de «répondre» à Ferré par une bien fade «Les Communistes» qui, même chantée par Pia Colombo, fleure la «chanson engagée» dans tout ce que celle-ci peut avoir de triste et de convenu à force de «tirer à la ligne».
Il est probable que l’intérêt de Ferré pour le rock de cette époque n’ait pas été étranger à mon engouement pour son travail et que les accents électriques (orgue, violon, guitare et basse) et le jeu de la session rythmique de ZOO (1), un groupe de jazz-rock-progressif, avec lequel il enregistre «Le Chien», «La «The Nana» », «La Solitude» et «Le Conditionnel de variété» et part en tournée, aient accru mon adhésion à sa musique.
Sa «curiosité» tranchait avec l’esthétique conformiste et l’«austérité»
des milieux d’extrême-gauche très peu enclins à examiner la possibilité
d’un front et d’une avant-garde artistiques, ce qui a fait qu’une partie
d’entre nous a discerné, à tort, une promesse dans les échos qui nous parvenaient de la Grande Révolution Culturelle Prolétarienne chinoise. En
ce domaine, nous étions pour beaucoup schizophrènes, regardant politiquement vers l’est mais vibrant émotionnellement en scrutant l’ouest…
Ferré, dont on a l’habitude de dire que la création a été stimulée voire
renouvelée par l’onde de choc suscitée à l’échelle planétaire par l’insurrection estudiantine récusant, autour de l’année 68, l’american way of life et la consommation à tout crin, a ensuite constitué, – il serait bien sot de le taire -, le viatique dans lequel je me suis, chaque fois que nécessaire, consolé de mes déboires et de mes chagrins d’amour, puisant dans «Tu ne dis jamais rien (1) » (La Solitude) et dans «Les Amants tristes (3)» (L’Espoir) de quoi oindre mes peines et mes blessures.
(1) Le groupe ZOO est composé par André Hervé (orgue électrique, piano, guitare électrique), Michel Ripoche (trombone, saxophone ténor, violon électrique), Daniel Carlet (saxophones alto, baryton, soprano, flûte, violon électrique), Michel Hervé (basse électrique) et Christian Devaux (batterie, percussions). On peut consulter à propos de cette collaboration ZOO/Ferré : http://rock-prog.over-blog.com/article-leo-ferre-et-le-
groupe-zoo-la-solitude-1971-110123482.html
(2) « Et tu ne me dis rien tu ne dis jamais rien/Mais tu luis dans mon coeur comme luit cette étoile/Avec ses feux perdus dans des lointains chemins/Tu ne dis jamais rien comme font les étoiles. »
(3) « Dans le feu de tes yeux mon regard s’est éteint//Crie crie crie//Tu es moi. JE c’est toi/Comment t’appelles-tu ?/Tu t’appelles la nuit dans le ventre des filles/De ces filles qui roulent au bord de la mort lente/Tu t’appelles l’amour Tu es toutes les femmes/Tu es TOI tu es ELLES/Des niagaras vernis me tombent dans la gueule//Crie crie crie// Tu n’es plus là parce que tu es moi/Et que je suis ailleurs/JE et TOI C’est tout comme/
Et l’on s’en va mourir au club des nuits cassées//Qui dont réparera l’âme des amants tristes/Qui donc réparera l’âme des amants tristes/Qui donc réparera l’âme des amants tristes// Qui donc ?»
Si je n’occulte pas «le lieu d’où je parle», c’est que je suis persuadé que les voies d’accès à Ferré qui ont été les miennes ne sont pas si éloignées des interrogations soulevées par et dans ses textes et ses chants, et que je me suis en partie «découvert» dans sa production, celle-ci ayant eu pour moi la même fonction et le même effet que, pour citer «À toi» (L’Été 68), «les culottes des femmes où le monde se mire». C’est donc de ce Ferré, celui qui a bercé les utopies de mon adolescence et de mes premiers pas dans l’âge adulte, pansé les désillusions qu’a provoquées l’expérience des « eaux glacées du calcul égoïste » et veillé sur mes aubes blanches que je veux vous entretenir, à partir d’un corpus de six albums couvrant les années 1969-1974 : L’Été 68, 1969 ; Amour Anarchie, 1970 ; La Solitude, 1971 ; Il n’y a plus rien, 1973 ; Et… Basta !, 1973 ; L’Espoir, 1974.
Nous, nous sommes pour un langage où vous n’entravez que couic (1)
«[L]a lumière ne se fait que sur les tombes» («Préface», Il n’y a plus rien), Léo Ferré ne s’est pas contenté de le proclamer, il l’a chanté. Il n’empêche que, pour ce qui le concerne, la célébration a commencé de son vivant, l’opinion publique et la critique journalistique dominante ayant pris l’habitude de l’associer à Georges Brassens et à Jacques Brel pour voir en lui l’une des figures majeures de « la chanson à texte » en français. J’avoue que cette expression qui, en y mettant les formes, sert à distinguer les chansons témoignant d’une grande attention portée à la langue et à leur écriture des « tubes » destinés à la consommation courante des auditeurs, me paraît singulièrement équivoque et ambiguë, parce que, selon moi, les paroles d’une chanson ont dans tous les cas leur importance et qu’elle permet de réunir les productions des trois artistes que je viens de citer avec celles d’Alain Souchon ou d’Yves Duteil, ce à quoi j’hésiterai beaucoup à me résoudre.
Mais laissons cela et revenons à Ferré.
C’est au lendemain de Mai 1968, très exactement le 6 janvier 1969, que François-René Cristiani, alors jeune journaliste à RTL, et Jean-Pierre Leloir ont accueilli Brassens, Brel et Ferré (ainsi que deux preneurs de sons) dans un appartement privé de la Place Saint-Placide à Paris. Cette rencontre a été immortalisée par une série de photographies prises par Leloir, dont l’une est dans toutes les mémoires, ou presque, du fait de sa commercialisation et de sa très large diffusion notamment sous forme de «poster». L’échange qui s’en est suivi a parachevé un processus de légitimation au terme duquel les trois artistes ont été systématiquement salués et reconnus en tant que «poètes», et plus précisément encore comme «poètes libertaires».
1. « Le Chien » (Amour Anarchie).
Il n’est pas sans signification pour mon propos que, pendant toute leur conversation, et alors qu’un ouvrage de la collection « Poètes d’aujourd’hui » chez Seghers a été consacré à chacun d’entre eux, sans doute à la fois par gêne et par pudeur, Brassens, Brel et Ferré ne reprennent pas franchement à leur compte l’épithète de «poète», lui préférant des formulations bien plus modestes : Brassens se peint comme quelqu’un qui «mélange des paroles et de la musique» pour les «chant[er]» ; Brel se définit comme un «chansonnier» et un «petit artisan de la chanson» ; Ferré, qui les «rej[oint], n’accepte quant à lui cette caractérisation, celle de «poète», que si cet éloge équivaut à «[lui dire] qu[’il est] un cordonnier qui fait de belles chaussures (1) », puis rapproche leur condition d’«hommes publics» de celle des prostituées, puisque les uns et les autres s’appliquent à «vend[re] quelque chose de [leur] corps (2)», son point de vue étant très proche de celui qu’il va proférer dans « Rotterdam (3)» et dans «Sur la scène (4)», deux titres de l’album Amour Anarchie en 1970, ainsi que dans «Basta (5)» sur lequel s’ouvre Et…Basta en 1973. Quoi qu’il en soit, tout au long de la discussion, Brassens, Brel et Ferré se désignent sous le vocable de «copains». Cela ayant été posé, force est de constater que cet entretien désormais qualifié «d’anthologie (6)» ou de «mythique (7)» correspond vraisemblablement au moment où, dans l’ordre du symbolique, les industries du divertissement francophones enregistrent littéralement la réussite de ces trois auteurs-compositeurs-interprètes.
(1) Ferré a repris cette idée dans « Words…Words… Words… » : « Et qu’ont-ils à rentrer chaque année les artistes ?/J’avais sur le futur des mains de cordonnier/Chaussant les astres de mes peaux ensemellées/La conscience dans le spider je mets les voiles » (in La Mauvaise Graine, p. 452 – album La Violence et l’ennui).
(2) On trouve la transcription de cette conversation sur le site : http://snoopairz.free.fr/
(3) Il y souligne l’ambivalence d’un «port du Nord» qui «plaît surtout quand on n’y est pas» et que «ça fait qu’on voudrait y être», de telle sorte que «ça fait qu’on ne sait pas bien s’il faut se taper le poète ou se taper la putain».
(4) Il y claironne que «[s]ur la scène y’a un’ pute avec des yeux abstraits/Sur la scène y’a tout ça et y’a même un anar».
(5) Il y raconte comment les péripatéticiennes le hélaient sur un ton gentiment moqueur : «Je rentrais chaque nuit dans le désert de Paris./Les putains ne m’accrochaient jamais. Elles savaient que j’étais un homme public. Elles, les filles publiques…/-Alors, comme ça, on se prostitue, Ferré!»
(6) http://brassensbrelferre.free.fr/index.php
(7) http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/culture/article/1969-brel-ferre-brassensla-59694
Ce processus de légitimation qui reconnaît à chacun une place au « panthéon » de la chanson prend cependant soin de les distinguer : dans les institutions comme parmi les spectateurs et auditeurs, Léo Ferré est nettement moins consensuel que Brassens et Brel, probablement parce que l’anarchisme bonhomme du premier n’est plus de nature à scandaliser les «assis» et que la geste du second suscite la compassion et la sympathie à travers son identification à «l’Homme de la Mancha», au «chevalier errant (1)» parti en quête d’un «impossible rêve» et d’une «inaccessible étoile (2)», tandis que la révolte innervant l’oeuvre de Ferré et sa trajectoire sont nettement plus urticantes, y compris parmi celles et ceux qui, idéologiquement, sont supposés partager quelques-unes de ses convictions, et ensuite appelées à devenir quasiment incompréhensibles aux yeux du plus grand nombre, du fait des transformations qui, à cette époque, s’amorcent et vont jusqu’à aujourd’hui bouleverser le mode de transmission des savoirs et de la culture, tout comme le rapport aux arts et l’usage de la langue, et leur fonction distinctive au sein de la sphère sociale. J’ignore si cette consécration stratifiée des trois artistes que j’évoque a rejailli sur le comportement qu’une partie du public a adopté envers Léo Ferré, ou si les reproches parfois véhémentement énoncés que celui-ci a essuyés à la charnière des années soixante et soixante-dix lors de ses récitals ont été en quelque sorte «formalisés» dans et par la «lecture» que la postérité fait de sa trajectoire en contrepoint de celles de Brassens et de Brel.
(1) http://www.youtube.com/watch?v=Ai5jqMlxR2A
(2) http://www.jukebo.fr/jacques-brel/clip,la-quete,8sup0.html
Alors qu’une fraction de l’opinion, laquelle n’a pas intégré qu’on ne rattrape pas le train de la Révolution quand on a été dans l’incapacité d’y monter, vit avec la certitude que dans un futur proche une nouvelle confrontation sociale est inévitable et qu’elle renversera l’ordre établi en parachevant ce qui a été entamé lors d’un mouvement de Mai dont on ne retient pas qu’il a été un échec, puisqu’au contraire on l’exalte comme le «début (1)» d’un processus qu’aucune force conservatrice sera à même d’endiguer, les spectacles donnés par Ferré sont perturbés par une minorité l’attaquant bruyamment pour ce qu’elle ressent, dans ses textes et dans ce qu’elle entrevoit de sa relation au monde et aux autres, comme la marque de louches accointances avec le «système» et le «show business et les manifestations d’une inacceptable et intempestive misogynie – des féministes stigmatisant le registre de « Ton Style (2) » (dans La Solitude) et de «Le Chien (3)» (dans Amour Anarchie) jugé outrageusement sexiste. Blessé et ulcéré qu’on mette en doute la sincérité de ses convictions, Ferré répond à ces allégations, publiquement, par exemple dans «Basta (4)» pour ce qui est de son rapport à l’argent, le ton ironique, faussement désabusé, de « L’Idole (5)» (dans L’Été 68) ne suffisant pas à contrer les diatribes qui lui sont adressées. Sur scène, il fait face crânement, en se tournant systématiquement vers l’une de ses plus virulentes contemptrices, qu’il désigne de la main, avant de lui dédier un «À toi (6) » (L’Été 68) qui, le plus souvent, la réduit au silence.
Quarante ans plus tard, force est de constater que la société de l’information qui est la nôtre, celle des écrans tactiles et du spectacle généralisé, a avalisé l’ambivalente « canonisation » dont Léo Ferré a été l’objet de son vivant, laquelle tend, de surcroît, en tressant des lauriers au poète à méconnaître le (bon) musicien qu’il était.
À l’école de la poésie, on n’apprend pas. ON SE BAT ! (7)
Dans la France de la Libération et des années cinquante, le rapport de la littérature et des arts à l’Histoire et à la politique est surdéterminé par les
(1) Un « slogan » cristallise cet espoir, celui de la « génération de mai-juin 68 » : «Ce n’est qu’un début, continuons le combat ! »
(2) La structure oxymorique du texte ne désarme pas les détracteurs de Ferré : « Ton style c’est ton cul c’est ton cul c’est ton cul/Ton style c’est ta loi quand je m’y plie salope!/C’est ta plaie c’est mon sang c’est ma cendre à tes clopes/Quand la nuit a jeté ses feux et qu’elle meurt/Ton style c’est ton coeur c’est ton coeur c’est ton coeur »
(3) « NOUS SOMMES DES CHIENS et les chiens, quand ils sentent la compagnie,/Ils se dérangent et on leur fout la paix/Nous voulons la Paix des Chiens/Nous sommes des chiens de « bonne volonté »/Et nous ne sommes pas contre le fait qu’on laisse venir à nous certaines chiennes/Puisqu’elle sont faites pour ça et pour nous »
(4) « -Dis-donc, Léo, ça ne te gêne pas de gagner de l’argent avec tes idées ?/-Non. Ça ne me gênait pas non plus de n’en pas gagner avec mes idées, toujours les mêmes. Il y a quelques temps./Vois-tu, la différence qu’il y a entre moi et Monsieur Ford ou Monsieur Fiat, c’est que Ford ou Fiat envoient des ouvriers dans des usines et qu’ils font de l’argent avec elles./Moi, j’envoie mes idées dans la rue et je fais de l’argent avec elles. Ça te gêne ? Moi, non ! Et voilà ! »
(5) « J’ai mis mon costume sorti du pressing/Ce vestiaire anglais où on lave même le spleen/Un chanteur qui chante la révolution/Ça planque sa cravate ça met un col Danton/ Regarde-moi bien/J’suis une idole »
(6) «ET PUIS le majuscule ennui qui nous sclérose/Mon pauvre amour car nous pensons les mêmes choses/En attendant que l’Ange nous métamorphose… »
(7) «Préface» (Il n’y a plus rien).
thèses sartriennes développées en 1947 dans Qu’est-ce que la littérature?, lesquelles gagnent à être appréhendées comme un symptôme, celui de la «conscience malheureuse» d’une société française cherchant à maquiller son impuissance et son épuisement relatifs dans une geste de la Résistance («inventée» et diffusée de concert par les gaullistes et les communistes), et à se dédouaner de ses responsabilités devant les peuples qu’elle a colonisés à travers la solidarité apportée par son intelligentsia (dont le centre de gravité, à droite avant guerre, s’est nettement déplacé à gauche) aux luttes d’un Sud désigné à partir de 1952 sous le vocable de «Tiers-Monde».
Convergeant pour assigner à la littérature une fonction, celle de «servir» une cause (1), Sartre et les tenants du réalisme socialiste supplantent aisément à la fois le «carré» surréaliste appréciant toute «poésie de circonstance» comme un « déshonneur » et les «Nouveaux Romanciers» en quête de ce que pourrait être la forme « contemporaine » du roman qui, à l’instigation d’Alain Robbe-Grillet, sont accueillis par Jérôme Lindon aux Éditions de Minuit, c’est-à-dire au sein de la maison authentiquement résistante qui a publié en 1943 le recueil L’Honneur des poètes (2). Les conditions dans lesquelles se déroule le débat valorise le «discours orné» et l’intention des écrivains au détriment de la prise en compte du travail de l’écriture proprement dit : Sartre privilégie la prose capable de faire «signe» et d’orienter les lecteurs contre la poésie qui considère la langue comme un matériau, à la façon dont la peinture et la musique traitent la couleur et les sons.
(1) Se reporter à la formule célèbre de Sartre : «La prose se sert des mots, la poésie sert les mots.» (Qu’est-ce que la littérature ?)
(2) Dans un article relativement ancien intitulé «Des Poètes et de leur insoumission», j’ai examiné les conditions et les enjeux de la polémique opposant les surréalistes (Breton et Péret) à Sartre et aux écrivains influencés par le Parti communiste (Tzara, Eluard, Vailland).
En le consultant, le lecteur de la présente communication y trouvera des éléments lui permettant de se représenter le « paysage » politique et intellectuel entre 1945 et le début des années cinquante. (in Modernité et romantisme, Textes réunis par Isabelle Bour, Eric Dayre et Patrick Née, Honoré Champion, 2001, pp. 371-385).
En négligeant les implications esthétiques du questionnement philosophique et éthique qui, outre rhin, pousse Adorno à estimer qu’«[é]crire un poème après Auschwitz est barbare» (Prismes, 1955) et en taxant de «formalisme» le souci des «Nouveaux Romanciers» de ne pas prolonger davantage les illusions de la représentation vériste, pour exalter l’articulation de la création à une cause «juste» et «émancipatrice», l’action des partisans de cette ligne littéraire et artistique « progressiste » aboutit d’un côté à encourager (par défaut) une « intellectualisation » et un hermétisme accrus de l’écriture poétique, et de l’autre à réactualiser un « vers français » et une prosodie qu’Apollinaire et les surréalistes avaient remisés dans les rayons du passé. Bien que malgré eux, ils contribuent à une plus grande « ghettoïsation» de la poésie, de telle sorte que désormais, tendanciellement, celle-ci n’est populaire, au sens où elle est apte à toucher le plus grand nombre et à faire écho aux contradictions qui le structurent, que si elle est coulée dans un chant (1), ce qui n’équivaut nullement à un retour aux sources de son émergence mais correspond bien plutôt à une actualisation des pratiques qu’elle induit en vertu des transformations affectant l’économie politique et culturelle de la société. Cette évolution marginalisant la poésie dans d’étroits cénacles, Ferré ne la subit pas au moins pour deux raisons : le chanteur n’a pas seulement cure d’«illustrer» (en mettant en musique) les directives et les consignes d’une faction politique autoproclamée «avant-garde» ou «quartier général» de la révolution (2), il ne se réfère à aucun programme, et le revendique, quand il chante, définissant toujours son anarchisme comme un tempérament, une «assiette psychologique», une attitude existentielle (3) et quasiment jamais comme un ensemble cohérent de propositions
(1) Si cette observation restitue l’« état » et la « condition » de la poésie dans ce pays, il est des plus intéressants de la rapprocher de ce que Ferré a écrit au moment où il mettait en musique des poésies de Verlaine et de Rimbaud, en 1964 : « La poésie est dans la rue, avec la musique et grâce à la musique. » (« La Poésie est dans la rue », in La Mauvaise Graine, p. 229).
(2) « On ne fait pas la poésie avec des tracts. On la fait avec sa gueule bien ouverte sur les verbes habituels et de préférence actifs. » (« Technique de l’exil », in La Mauvaise Graine, p. 426).
(3) « Divine Anarchie, adorable Anarchie, tu n’es pas un système, un parti, une référence, mais un état d’âme. Tu es la seule invention de l’homme, et sa solitude, et ce qui lui reste de liberté. Tu es l’avoine du poète. » (« Préface », in La Mauvaise Graine, Textes, poèmes et chansons, 1946-1993, Préface et notes de Robert Horville, Paris, Éditions N° 1, 1993, p. 46). Et aussi : « L’anarchie est la formulation politique du désespoir. » (« L’Anarchie », La Mauvaise Graine, Textes, poèmes et chansons, 1946-1993, p. 280).
directement applicables à la sphère sociale (1) ; il se réclame d’une poésie qui se cristallise en actes autant qu’elle s’écrit, contestant la séparation de l’artistique du reste des activités et expériences humaines inhérente à l’invention et à l’instauration d’instances spécifiques de conservation et de commercialisation du « beau » dans le droit fil de l’extension capitaliste du règne de la marchandise à la totalité du vécu, ce en quoi il rejoint le « [p]lutôt la vie » cher à André Breton. À mille lieux du prêche et du prosélytisme, Ferré s’adresse à ses pairs (2). Durant quelque temps, le compagnonnage entre les deux hommes, noué à l’initiative de Breton, s’est nourri de cette volonté commune de ne pas cantonner l’art à des «quartiers réservés» ; il s’est aussi renforcé du souci de Breton d’auner l’ancrage social, les opinions et les productions de chacun au crible de « la poésie, la liberté et l’amour (3)», c’est-à-dire d’un mot d’ordre interprété par Ferré comme le principe même de souveraineté4, celui dont les individus ne sauraient se départir à moins de s’aliéner immédiatement. Cette parenté idéologique a aussi bénéficié d’un malentendu (qui est loin d’avoir été dissipé) touchant à l’écriture de Ferré laquelle a été jugée «surréalisante» sur la seule base de la profusion, de la richesse et de la hardiesse de ses images. Ce sentiment a été conforté par le phrasé de certains (assez longs) textes chantés et surtout clamés dans les albums produits dans la foulée de 1968, en lesquels beaucoup ont vu un «renouveau», ce qui n’était pas du tout le cas, puisque la plupart avait été rédigée la décennie précédente. Quoique rappelant l’éclat des grands
(1) « L’anarchie, cela vient du dedans. Il n’y a pas de modèle d’anarchie, aucune définition non plus. Définir, c’est s’avouer vaincu d’avance. Définir, c’est arrêter le train qui roule dans la nuit quand il s’écartèle à l’aiguillage. Autant dire qu’on est pressé d’en finir avec l’intelligence de l’événement. » (« L’Anarchie », in La Mauvaise Graine, Textes, poèmes
et chansons, 1946-1993, p. 287.
(2) « Je ne parle pas aux imbéciles, en ce moment, mais aux hommes qui se reconnaîtront à me lire et qui me prennent par le bras comme on prend un ami, son frère. » (« Le Style », in La Mauvaise Graine, p. 217).
(3) André Breton, Arcane 17.
(4). « Il n’y a plus rien// Et ce rien, on vous le laisse !/Foutez-vous-en jusque-là, si vous pouvez/Nous, on peut pas./Un jour, dans dix mille ans,/Quand vous ne serez plus là,/ Nous aurons TOUT/Rien de vous/Tout de Nous// Nous aurons eu le temps d’inventer la Vie, la Beauté, la Jeunesse,/Les Larmes qui brilleront comme des émeraudes dans les yeux des filles,/Le sourire des bêtes enfin détraquées,/La priorité à Gauche, permettez !// Nous ne mourrons plus de rien/Nous vivrons de tout » (Il n’y a plus rien).
recueils surréalistes, leur brillance ne doit que très peu à l’épanchement torrentiel du désir à l’oeuvre sous la barre du refoulement, ils sont en effet ciselés, concertés et ordonnancés par un Ferré rétif aux charmes du vers libre, de l’automatisme et des ressources de l’inconscient (1). Sa poétique a beau sollicité à un degré extrêmement élevé le levier de l’association, elle ne fait jamais du poète un sismographe ni un simple « enregistreur » des voix intérieures (2), elle magnifie au contraire son travail sur la langue. Breton ne pouvait pas l’admettre, la proximité de Ferré avec l’hôte de l’Atelier de la rue Fontaine avait par conséquent duré (3). La poétique libérée c’est du bidon (4) Aux antipodes du postulat surréaliste d’une parole « libérée » parce qu’affranchie du contrôle de la raison et débarrassée du poids des règles héritées de la « tradition » littéraire, le poète libertaire maintient la nécessité de la contrainte dans et pour la création (5). Sa défense du vers, son recours fréquent à la rime et un certain respect de la métrique n’en font cependant pas un «conservateur» ni un nostalgique. Son ambition n’est pas de perpétuer ni de ressusciter une prosodie dont il est un héritier
(1) Se reporter à «Préface», à «Poètes, vos papiers !» et à «Lettre à un ami d’occasion».
(2) «Le poète n’a plus rien à dire, il s’est lui-même sabordé depuis qu’il a soumis le vers français aux dictats de l’hermétisme et de l’écriture dite « automatique ». L’écriture automatique ne donne par le talent. Le poète automatique est devenu un cruciverbiste dont le chemin de croix est un damier avec des chicanes et des clôtures : le five o’clock de l’abstraction collective. » («Préface», in La Mauvaise Graine, p. 44). À rapprocher aussi de : «Mon refus est à moi et je ne peux le partager avec quiconque. Ma qualité d’artiste m’inclinerait, pensez-vous, à vous persuader. Mais je ne tiens nullement à m’inscrire sur vos carnets de téléphone. Je ne suis pas de vos connaissances. Quand je me rencontre, je m’évite, tellement je vous ressemble. Je trouve que la Révolte même n’est plus de mise. La Révolte, c’est une façon de rentrer dans la Cité. C’est une vertu tribale, une arme défensive. C’est une négation de complaisance. La Révolte – comme le Désespoir – est une forme supérieure de la Critique, mais une critique silencieuse – informelle, diriez-vous, dans votre jargon de géomètres télévus – oui, informelle et monstrueuse, c’est pour ça que je ne la sors guère.» («Technique de l’exil», in La Mauvaise Graine, pp. 418-419).
(3) Le Blog de Jacques Layani propose une synthèse de ce que l’on peut savoir des relations entre Breton et Ferré : http://leoferre.hautetfort.com/archive/2007/11/25/leo-ferre-et-les-surrealistesnouveaux- elements.html
(4) «La Mémoire et la mer» (Amour Anarchie).
(5) Se reporter par exemple à : «Le vers libre n’est plus le vers puisque le propre du vers est de n’être point libre.» (« Préface », in La Mauvaise Graine, p. 43).
critique. Empruntant allègrement à l’argot, à la langue familière et populaire, aux «idiotismes» et à l’oralité, son écriture est par exemple loin de reconduire les préjugés ayant trait à la «noblesse» et à l’élégance lexicales et syntaxiques qu’exigerait le poétique (1). Même s’il n’a pas la prétention ni l’objectif de faire table rase de l’arsenal poétique du passé, Ferré n’est certainement pas un « classique ». À l’image d’Arthur Rimbaud, il ne conteste pas que « la vieillerie poétique [a] une bonne part dans [s]on alchimie du verbe (2) ». Toutes les ressources rhétoriques et tous les procédés sont donc efficients, s’ils concourent à donner une forme à sa production. Évitant de s’enfermer dans un système, Ferré se méfie de la spéculation qu’il associe à « l’abstraction3 ». Il ne se détermine pas en idéologue ni en critique, encore moins en théoricien. Raillant volontiers Paul Claudel comme représentant de l’ordre moral bourgeois, méchamment rapproché sur le plan littéraire de l’auteur de vaudevilles Jean de Létraz, Ferré brocarde ainsi tout autant les tenants de la modernité : « Et j’ai joué au casino les subjonctifs/La chemise à Claudel et les cons dits modernes. (4)» Dans « Poètes, vos papiers ! », sa gouaille écorne
(1) « [La poésie contemporaine] a cependant le privilège de la distinction, elle ne fréquente pas les mots mal famés, elle les ignore. On ne prend les mots qu’avec des gants : à « menstruel » on préfère « périodique », et l’on va répétant qu’il est des termes médicaux qui ne doivent pas sortir des laboratoires et du Codex. Le snobisme scolaire qui consiste à n’employer en poésie que certains mots déterminés, à la priver de certains autres, qu’ils soient techniques, médicaux, populaires ou argotiques, me fait penser au prestige du rince-doigts et du baisemain. Ce n’est pas le rince-doigts qui fait les mains propres ni le baisemain qui fait la tendresse. Ce n’est pas le mot qui fait la poésie, c’est la poésie qui illustre le mot. » (« Préface », Il n’y a plus rien).
(2) Arthur Rimbaud, Délires II, Alchimie du verbe, in Une saison en enfer.
(3). « Du jour où l’abstraction, voire l’arbitraire, a remplacé la sensibilité, de ce jour-là date, non pas la décadence qui est encore de l’amour, mais la faillite de l’Art. Les poètes, exsangues, n’ont plus que du papier chiffon, les musiciens que des portées vides ou dodécaphoniques – ce qui revient au même -, les peintres du fusain à bille. L’art abstrait est une ordure magique où viennent picorer les amateurs de salons louches qui ne reconnaîtront jamais Van Gogh dans la rue… » (« Préface », in La Mauvaise Graine, pp. 44-45).
(4) « Art poétique », in La Mauvaise Graine, p. 49 et «Poètes, vos papiers !», Amour Anarchie.
férocement Tristan Tzara (1) et Jean Genet(2). Indifférent aux tentatives du Nouveau Roman et aux expérimentations textuelles promues par Tel Quel, Ferré n’est pas non plus atteint par la vague structuraliste et ses questionnements. Peu enclin à verser dans l’intellectualisme, il puise son inspiration dans cette « intelligence populaire » qui allie la spontanéité et la simplicité des couches défavorisées de la population à l’exaltation de la «culture légitime» appréhendée par elles comme un puissant moyen d’émancipation et un vecteur possible d’autonomie. Cette prévention à l’endroit des «écoles» et courants avant-gardistes soupçonnés de dogmatisme et de reproduction (malgré eux) de l’oppression sociale(3) s’étend dans le domaine musical au sérialisme et au dodécaphonisme, à la musique concrète et électroacoustique, Pierre Boulez étant régulièrement fustigé comme l’incarnation même de cette dérive élitiste stérile. En général, ce ne sont pas des a priori esthétiques constitués et érigés en recettes poétiques qui guident Ferré mais une position résolument éthique : « Tu peux vêtir ta Muse ou la laisser à poil/L’important est ce que ton ventre lui injecte (4) ». Voilà pourquoi Ferré n’envisage la poésie qu’assortie à la musique, c’est-à-dire munie du « véhicule fantastique » par le biais duquel elle manifeste sa vitalité et se répand « dans la rue (5) », conquérant émotionnellement, presque charnellement, les individus.
(1) « Cependant que Tzara enfourche le bidet/À l’auberge dada la crotte est littéraire/ Le vers est libre enfin et la rime en congé/On va pouvoir poétiser le prolétaire » (« Art poétique », in La Mauvaise Graine, p. 49 et « Poètes, vos papiers ! », Amour Anarchie).
(2) « Littérature obscène inventée à la nuit/Onanisme torché au papier de Hollande/Il y’a partouze à l’hémistiche mes amis/Et que m’importe alors Jean Genet que tu bandes » (« Art poétique », in La Mauvaise Graine, p. 49 et « Poètes, vos papiers ! », Amour Anarchie)
(3) « L’embrigadement est un signe des temps, de notre temps. Les hommes qui pensent en rond ont les idées courbes. Les sociétés littéraires sont encore la Société. » (« Préface », Il n’y a plus rien).
(4) « Art poétique », La Mauvaise Graine, p. 49 et « Poètes, vos papiers ! », Amour Anarchie.
(5) « On y arrive. La poésie est dans la rue. Uniquement. Le Temps des cerises, dans un livre, ça n’est même pas lisible. Dans la rue, il t’enchante. Et voilà, elle arrive la Musique, ce véhicule fantastique qui ne s’arrête pas et qui vient dans tes oreilles. Et puis, qui repart, là-bas, dans les canalisations de l’Amour, du courage et de la splendeur. La poésie est dans la rue. Elle te regarde. Prends-la dans tes bras. » (« La Poésie est dans la rue », in La Mauvaise Graine, p. 230)
La Poésie est une clameur, elle doit être entendue comme la musique (1)
Si, au début des années soixante, Léo Ferré a moqué le yé-yé et la vogue de Salut les copains(2), à la fin de la décennie, sa dénonciation de la passivité de l’opinion publique française (« Ils ont voté » et « La Grève » en 1967) va de pair avec une « réhabilitation » d’une jeunesse que l’année 68 a posée en agent et ferment des transformations sociales espérées. Aussi prend-il fréquemment les jeunes à témoin pour exprimer sa révolte(3). Et c’est dans la « langue » qui est alors parfois la leur, celle d’un rock mâtiné de free-jazz, qu’il psalmodie littéralement sa colère : si, chez John Coltrane et dans A Love supreme, la voix a fini par suspendre la musique et son déroulé lancinant, chez Ferré, les paroles des chansons tendent à s’affranchir de tout support mélodique pour s’intégrer à un dispositif où texte et musique sont en échos l’un par rapport à l’autre, et non plus dans une relation de mise en valeur et de « soulignement » du propos par un accompagnement harmonique. Cette voie, comparable à celle explorée en 1972 par Colette Magny dans son album Répression(4), fait d’ailleurs de Ferré un des précurseurs du slam en français. Elle s’inscrit dans le prolongement même du travail de l’artiste, dans son effort permanent de ne jamais séparer la musique de la poésie : « Le vers est musique ; le vers sans musique est littérature(5).» Parce que, pour Ferré, la poésie est fondamentalement chant, le poète ne se confond pas avec le « simple » écrivain (si vous me permettez cette modalisation), a fortiori avec le littérateur ; l’anime la certitude que « [l]a syntaxe du vers est une syntaxe harmonique – toutes licences comprises(6)». Sans cette mise en voix et en chant de la poésie, celle-ci serait condamnée à une espèce d’inachèvement confinant à un état de manque et
(1) « Préface » (Il n’y a plus rien).
(2) Se reporter aux chansons «Époque épique» en 1964 et «Le Palladium» en 1966.
(3) «Alors que ces enfants dans les rues s’aiment et s’aimeront/Alors que cela est indéniable/Alors que cela est de toute évidence et de toute éternité/JE PARLE POURDANS DIX SIECLES et je prends date/On peut me mettre en cabane/On peut me rireau nez ça dépend de quel rire/JE PROVOQUE À L’AMOUR ET À LA REVOLUTION/YES ! I AM UN IMMENSE PROVOCATEUR/Je vous l’ai dit/Des armes et des motsc’est pareil/Ça tue pareil/Il faut tuer l’intelligence des mots anciens/Avec des mots tout
relatifs, courbes, comme tu voudras » (« Le Chien », Amour Anarchie).
(4) Se reporter en particulier aux chansons « Babylone USA » et « Répression ».
(5) «Préface», in La Mauvaise Graine, p. 43.
(6) Ibidem, p. 43.
d’axesuation(1). La rencontre du texte et de la musique s’apparente à celle d’un couple d’amoureux : elle est « fortuite(2) » et dès plus aléatoires car la phrase, même versifiée, ne « porte » pas en elle-même de ligne mélodique, celle-ci lui étant extérieure, il convient de l’énoncer dans une forme qui soit « propice » à cette adjonction(3) ; qui plus est, elle fait de la dernière [l’]« épouse(4)» de la première ; leurs noces ne sont heureuses que si elles parviennent, comme les « enfants » qu’évoque Ferré dans « Le Chien », à atteindre l’accomplissement dans la « VRAIE GALAXIE DE L’AMOUR INSTANTANÉ(5) ». La poésie se distingue par conséquent radicalement du style, lequel procède d’une opération de discernement impliquant « un arrêt dans la culture(6) », puisque la plénitude de celle-ci est à bien des égards « orgasmique » et aussi foudroyante qu’une flèche décochée par un archer(7).
(1) « Toute poésie destinée à n’être que lue et enfermée dans sa typographie n’est pas finie ; elle ne prend son sexe qu’avec la corde vocale tout comme le violon prend le sien avec l’archet qui le touche. » (« Préface », Il n’y a plus rien).
(2) « La rencontre du musicien et du poète est fortuite. » (« La Mise en musique », in La Mauvaise Graine, p. 141 et sur la pochette de l’album Les Chansons d’Aragon chantées par Léo Ferré, 1961).
(3) « Je ne crois pas tellement à la musique du vers mais à une certaine forme propice à la rencontre du verbe et de la mélodie. » (Ibidem).
(4) « Le piano est fauteur de troubles. Quand tout dort dans le cabinet de travail, et que la page blanche est le seul recours possible contre les assauts perfides de la mélancolie, du mal de vivre et d’écrire, du sentiment vague de l’inutilité de « faire ». Le musicien arme sa clef et part rêver au coin d’un do dièse mineur, il improvise, il s’arrête, il reprend, il souffre. Le piano est fauteur de troubles car il donne au musicien tout un monde d’innocence créatrice, de silence, en même temps que des possibilités d’architecture, des ouvertures sur des horizons multiples et, sournoisement, l’occasion permanente du verbiage. La musique pure est subjective. La musique, épouse d’un texte, par contre est objective. Le mariage est bon ou il n’est pas. Il n’y a pas de faux couples, pas en tout cas qui relève de la critique. Ce mariage-là est un don du hasard, de la rencontre. » (Ibidem).
(5) « ALORS QUE CES ENFANTS SONT TOUT SEULS DANS LES RUES/ET S’INVENTENT LA VRAIE GALAXIE DE L’AMOUR/INSTANTANÉ » (« Le Chien », Amour Anarchie).
(6) « Le style c’est cette partie du beau qui s’analyse, dans le repos, quand le spectacle flanche. C’est un arrêt dans la culture, pour mieux goûter. » (« Le Style », in le Volume Ferré de la Collection « Poètes d’aujourd’hui », Seghers, 1962 ; in La Mauvaise Graine, p. 215).
(7) « La poésie est une fureur qui se contient juste le temps qu’il faut, pendant que se bande l’arc, là, au milieu de la flèche. Elle doit respirer, elle s’étire d’aise et puis s’en va, vers sa destination. » (Ibidem, p. 215).
En guise de conclusion
Si la littérature est bien l’Autre de la théorie, pour reprendre une formule de Louis Althusser, c’est-à-dire qu’elle délivre un savoir sur le réel et la réalité à travers un mode sensible chaque fois que l’effort d’intellection bute sur eux et sur les problèmes qu’ils posent aux hommes, et demeure dans l’impossibilité d’y apporter une solution dans ce cadre et sur ce plan, il est séduisant de poser que la fulgurance poétique de Ferré a trouvé, par le truchement d’un ouvroir d’images sollicitant remarquablement l’association et d’une musique non pas « déduite » des textes mais articulée à eux, pour les avoir « amoureusement » et « érotiquement » rencontrés, « dit » et dénonce la société française mieux et avec plus de force que l’ordinaire production « à thèse », en particulier dans les chansons déclamées à motifs improprement qualifiés de « surréalisants ». L’artiste « irréconcilié » avec le temps qui passe (et qui emporte tout) et l’organisation sociale, a érigé le désespoir, peut-être pour ne pas s’y naufrager, en outil critique à valeur emblématique puisque revendiqué comme la définition même de l’anarchisme. Cet « affichage » a été cependant continument renversé dans l’expression « politique » d’un espoir. Son combat, à portée existentielle, Ferré l’a assumé en effet en le drapant dans les plis de ce sentiment, dont il me semble qu’il s’apparente chez lui à une version laïque de l’espérance, l’une des trois vertus théologales du christianisme. Par cette remarque, il ne s’agit pas pour moi de tirer Ferré malgré lui du côté d’un Dieu auquel il ne croyait pas : « L’âme de certains individus m’empêchera toujours de croire tout à fait à Dieu(1) » Je me contenterai d’émettre l’hypothèse que son « engagement » participait de cette dimension religieuse qui trame vraisemblablement tout militantisme et qui permet à celles et ceux qui s’y investissent de vivre intensément leur présence au monde, en s’immergeant au sein d’une communauté régie par des rapports passionnels apparentés à ceux d’une fratrie. La part accordée à l’Espagne républicaine, à sa mythologie et à son tragique dans l’univers mental (et politique) de Ferré me conforte dans cette impression.
(1) « Basta », Et Basta !