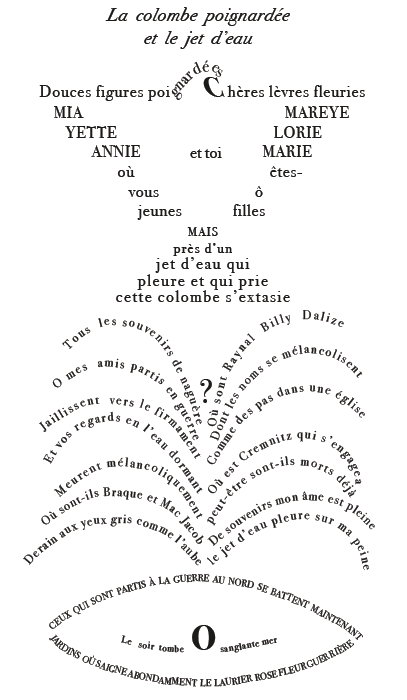Le métis Crunet
En attendant le vote des bêtes sauvages, Le Seuil, 1998.
Veillée II «une pirogue n’est jamais trop grande pour chavirer», extrait.
Ahmadou Kourouma (1927-2003 )
L’Ivoirien, d’origine malinké, Ahmadou Kourouma est un génie de la littérature. Il est notamment l’auteur de : Soleils des Indépendances (1968), Le diseur de vérité (1972, pièce de théâtre censurée en Côte d’Ivoire), Monnè, outrages et défis (1990), Yacouba, chasseur africain (1998), Allah n’est pas obligé (2000, prix Renaudot, prix Goncourt des lycéens et prix Amerigo-Vespucci), Paroles de griots (2003, avec Ousmane Sow), Quand on refuse on dit non (roman inachevé, 2004). Poète engagé, il connu la prison et l’exil… Lorsqu’en 2002, juste avant sa mort, la guerre civile éclate en Côte d’Ivoire, il prend position contre l’ivoirité. Avec son roman, En attendant le vote des bêtes sauvages (prix du Livre Inter), il lie poésie et récit historique en dressant le portrait de plusieurs dictateurs africains dont Houphouët-Boigny, Bokassa, Mobutu, Sékou Touré, Gnassingbé Eyadema, Hassan II… Ce conte est avant tout militant. Kourouma y dénonce toutes les pratiques machiavéliques des dirigeants africains. Le métis Crunet, adepte de la pensée colonialiste, n’est autre que la caricature de Nicolas Grunitzky (1913-1969), deuxième Président du Togo, né d’un père allemand et d’une togolaise…
(…) quatre chefs se partagèrent le pouvoir. Chacun eut une part ; chacun convoitait la totalité et croyait à sa chance de l’acquérir ; à chacun, les devins et les marabouts avaient fait croire qu’il était prédestiné à devenir Président à vie de la République. Il y avait d’abord le Capitaine Koyaga (…) en second lieu le Colonel Ledjo (…). Il y avait Tima (…). Il y avait enfin le métis Crunet… Quand tu rencontres un mulâtre, tu es en face d’un homme malheureux de ne pas être un Blanc, mais heureux de ne pas être un Noir. La vie est toujours douloureuse pour les gens qui aiment ceux qui les excluent et méprisent ceux qui les acceptent. J.-L. Crunet était un mulâtre. Mais un mulâtre chanceux qui vécut sa prime jeunesse dans la malchance et la damnation du colonisé et la presque totalité de sa vie dans l’opulence et l’arrogance du Blanc colonisateur.
Un jour, un garde-cercle vigilant vit arriver des garnements au bord d’un marigot. Ils étaient quatre. Tous les quatre pieds nus et morveux. Tous les quatre également noirs de crasse comme des mouches. Ils se jetèrent à l’eau. Le garde-cercle avec surprise constata que le quatrième garçonnet devenait blanc quand il plongeait et se lavait, de plus en plus blanc au fur et à mesure qu’il replongeait et se relavait. Il s’en approcha et vérifia que le garnement n’était ni albinos ni Maure ou Peul, mais un Blanc, un vrai Blanc. Le consciencieux garde-cercle ne put se contenir, courut jusqu’à la résidence du commandant blanc, appliqua un parfait salut militaire et bien qu’essoufflé informa le chef de la subdivision de sa découverte. Le commandant sur-le-champ manda le chef du village, l’interprète, la mère et son galopin. Il fut demandé à la jeune femme de relever devant toutes les notabilités de la ville le nom du pays lointain où elle s’était dévoyée jusqu’à porter au dos un petit métis.
La mère, tremblant de peur, expliqua qu’elle n’avait jamais quitté les collines mais rappela que, lors de la dernière rébellion des montagnards nus du Nord, un détachement de passage commandé par un lieutenant blanc avait bivouaqué des semaines dans le pays. En raison de sa beauté et de sa virginité, elle avait été chargée de préparer l’eau chaude pour le lieutenant blanc et de savonner le dos de l’officier au cours de ses bains de nuit et de lever. Elle lava et relava nuit et jour le dos de son Blanc et ne se limita qu’à cette tâche. Quelle ne fut pas sa surprise de constater quelques semaines seulement après le départ du détachement qu’elle portait bel et bien une grossesse. Tout le monde convint de la vérité historique du séjour dans le pays d’une compagnie de tirailleurs commandée par un lieutenant blanc.
L’administrateur blanc du cercle des collines se fâcha, réprimanda et menaça tout le monde : l’interprète, les chefs de canton, du village, de la tribu et la jeune mère. Les indigènes n’avaient pas le droit de dissimuler et d’élever un mulâtre dans leurs insalubres cases. Il le leur avait plusieurs fois expliqué. Un mulâtre est un demi-Blanc donc pas un Nègre. Dès le lendemain, l’enfant fut arraché à sa mère et, sous bonne escorte, envoyé au foyer de métis de la capitale de la colonie où on le savonna plusieurs fois, le chaussa, l’habilla, le coiffa et l’envoya sur un banc. Il fut heureux et se révéla intelligent, travailleur et encore chanceux. Très chanceux. Un matin, pendant la récréation, toute l’école se mit à l’appeler, à le rechercher. Il se rendit accompagné d’une foule de camarades au bureau du directeur du foyer. Le directeur le félicita et lui annonça son départ pour la métropole par le prochain bateau…
Sa grand-mère de France, une vieille rombière, avait découvert en relisant les carnets de route de son fils éliminé par la fièvre jaune qu’elle avait un petit-enfant parmi les sauvages de la brousse africaine. Il me faut vite le récupérer pour que les cannibales ne me le dévorent pas, s’écria-t-elle en pleurant. Elle était riche, puissante financièrement et politiquement. Sans perdre une minute, elle s’en alla successivement aux ministères de la Guerre et des Colonies. Les gouverneurs et tous les administrateurs des colonies furent mobilisés, tout fut mis en oeuvre ; le petit métis fut déniché. La vieille l’aimait avant de l’avoir vu ; elle l’aima quand elle l’accueillit et le pratiqua. C’était un mignon de garçon à qui on fit perdre immédiatement ses noms imprononçables nègres de Dahonton N’kongloberi et qu’on baptisa de ceux civilisés et catholiques de Jean-Louis Crunet.
J.-L. Crunet ne se révéla pas seulement un bon catholique croyant et pratiquant, mais un authentique Crunet. Un Crunet dans les veines duquel n’aurait jamais coulé la moindre goutte de sang colonisé. Il franchit comme un plaisir tous les obstacles qui sont proposés, pour les éprouver, aux futurs dirigeants de la France éternelle. Brillamment il réussit aux concours communs aux grandes écoles et entre toutes, comme tout bon Crunet, il préféra l’École Polytechnique. Et après sa classe dans la cavalerie entra à l’École des ponts et chaussées. En France métropolitaine, il se comporta socialement et moralement comme un Crunet jusqu’à quarante ans. Au-delà de la quarantaine, ce furent les séquelles de ses ascendances nègres qui surgirent et eurent le dessus. L’appel du sang est assurément irrésistible, on ne fait jamais d’une hyène un mouton. À la surprise de tous les Crunet, Jean-Louis commença à s’adonner aux jeux, à tromper sa femme qu’il aimait pourtant. Celle-ci obtint la séparation. Pour noyer son dépit amoureux, il fréquenta Pigalle où il s’enticha d’une Négresse aussi sensuelle, aguicheuse et sex-appeal que Joséphine Baker. Il se perdit dans l’alcool et les stupéfiants. D’un tournemain, il dilapida la fortune que lui avait léguée sa grand-mère. Rejeté par sa race et son milieu, il se souvint de son ascendance nègre, se présenta au ministère des Colonies publiquement et à haute voix déclara assumer pleinement sa négritude. Le ministre l’affecta dans son pays natal. À son débarquement, tous les Noirs de la colonie, fiers de posséder un polytechnicien au sein de leur race, l’accueillirent avec des tam-tams et des danses lubriques. La fête fut si spontanée, colorée, enthousiaste, grandiose et belle qu’elle donna une idée au gouverneur de la colonie. Le gouverneur depuis trois mois cherchait sans résultat un cadre, un responsable crédible parmi les intellectuels et personnalités nègres qui ne serait ni révolutionnaire ni anticolonialiste. Il lui fallait cet indigène instruit pour les prochaines législatives. Il voulait en faire le candidat pour lequel l’administration coloniale pourrait truquer les élections et faire échouer le favori nationaliste en se prévalant sans cesse de ses diplômes.