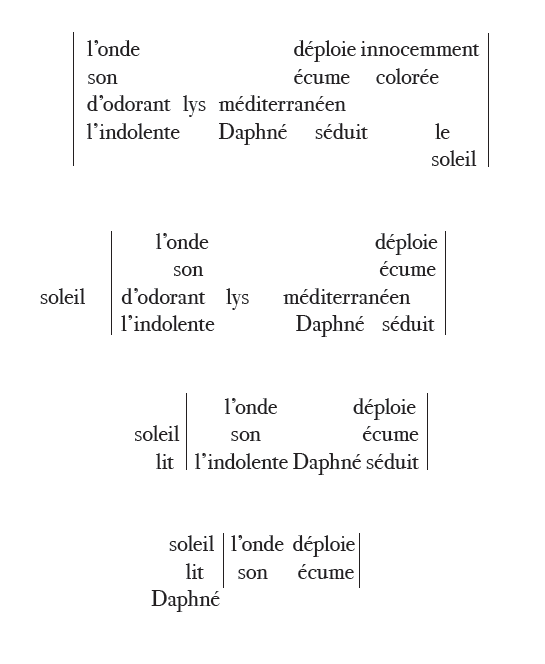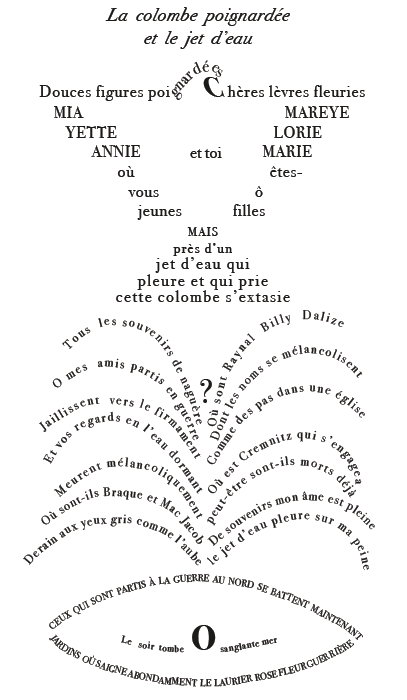Les Misérables (1862)
La mort de Gavroche
Victor Hugo (1802-1885)
Gavroche !… Dans Les Misérables, il est le titi de Paris, gai impertinent, spirituel, mauvaise tête et grand coeur, un gamin de France débrouillard qui meurt dans le brouillard d’une barricade. Il est la «petite grande âme» de la République qui, tel le géant vaincu par Hercule prenant ses forces au contact de la terre, reprend et perd les siennes en touchant le pavé… (…)
Il rampait à plat ventre, galopait à quatre pattes, prenait son panier aux dents, se tordait, lissait, ondulait, serpentait d’un mort à l’autre et vidait la giberne ou la cartouchière comme un singe ouvre une noix. De la barricade, dont il était encore assez près, on n’osait lui crier de revenir de peur d’attirer sur lui l’attention. Sur un cadavre, qui était un caporal, il trouva une poire à poudre.
– Pour la soif, dit-il en la mettant dans sa poche…
À force d’aller en avant, il parvint au point où le brouillard de la fusillade devenait transparent. Si bien que les tirailleurs de la ligne rangés et à l’affût derrière leur levée de pavés, et les tirailleurs de la banlieue massés à l’angle de la rue, aperçurent soudainement quelque chose qui remuait dans la fumée. Au moment où Gavroche débarrassait de ses cartouches un sergent gisant près d’une borne, une balle frappa le cadavre.
– Fichtre ! fit Gavroche, v oilà qu’on tue les morts !
Une deuxième balle fit étinceler le pavé à côté de lui. Une troisième renversa son panier. Gavroche regarda, et vit que cela venait de la banlieue. Il se dressa tout droit, debout, les cheveux au vent, les mains sur les hanches, l’oeil fixé sur les gardes nationaux qui tiraient, et il chanta :
On est laid à Nanterre,
C’est la faute à Voltaire,
Et bête à Palaiseau,
C’est la faute à Rousseau
Puis il ramassa son panier, y remit, sans en perdre une seule, les cartouches qui en étaient tombées, et, avançant vers la fusillade, alla dépouiller une autre giberne. Là une quatrième balle le manqua encore.
Gavroche chanta :
Je ne suis pas notaire,
C’est la faute à Voltaire,
Je suis petit oiseau,
C’est la faute à Rousseau.
Une cinquième balle ne réussit qu’à tirer de lui un troisième couplet :
Joie est mon caractère,
C’est la faute à Voltaire,
Misère est mon trousseau,
C ’est la faute à Rousseau.
Cela continua ainsi quelque temps. Le spectacle était épouvantable et brumeux. Gavroche taquinait la fusillade. Il avait l’air de s’amuser beaucoup. C’était le moineau becquetant les chasseurs. Il répondait à chaque décharge par un couplet. On le visait sans cesse, on le manquait toujours. Les gardes nationaux et les soldats riaient en l’ajustant. Il se couchait, puis se redressait, s’effaçait dans un coin de porte, puis bondissait, disparaissait, reparaissait, se sauvait, revenait, ripostait à la mitraille par des pieds de nez, et cependant pillait les cartouches, vidait les gibernes et remplissait son panier. Les insurgés, haletants d’anxiété, le suivaient des yeux. La barricade tremblait ; lui, chantait. Ce n’était pas un enfant, ce n’était pas un homme ; c’était un étrange gamin fée. On eût dit le nain invulnérable de la mêlée. Les balles couraient après lui, il était plus leste qu’elles. Il jouait on ne sait quel effrayant jeu de cache-cache avec la mort ; chaque fois que la face camarde du spectre s’approchait, le gamin lui donnait une pichenette.
Une balle pourtant, mieux ajustée ou plus traître que les autres, finit par atteindre l’enfant feu follet. On vit Gavroche chanceler, puis il s’affaissa. Toute la barricade poussa un cri ; mais il y avait de l’Antée dans ce pygmée; pour le gamin toucher le pavé, c’est comme pour le géant toucher la terre; Gavroche n’était tombé que pour se redresser; il resta assis sur son séant, un long filet de sang rayait son visage, il éleva ses deux bras en l’air, regarda du côté d’où était venu le coup, et se mit à chanter :
Je suis tombé par terre,
C’est la faute à Voltaire,
Le nez dans le ruisseau,
C’est la faute à…
Il n’acheva point. Une seconde balle du même tireur l’arrêta court. Cette fois il s’abattit la face contre le pavé, et ne remua plus. Cette petite grande âme venait de s’envoler…